La guerre des polices, film de Robin Davis, commentaire
Bienvenue sur le site d'un manipulateur de mots, passionné d'écriture, de cinéma, de musique, d'ésotérisme...
La guerre des polices, 1979,
de : Robin Davis,
avec : Claude Brasseur, Claude Rich, Marlène Jobert, Etienne Chicot, François Périer, Jean-François Stévenin, Rufus,
Musique : Jean-Marie Sénia
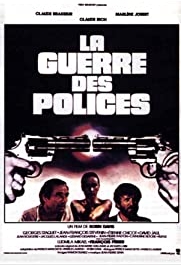
Le commissaire Ballestrat (Claude Rich), de la Brigade territoriale, est en planque devant le domicile d'un dangereux truand, Hector Sarlat (Gérard Desarthe), lorsqu'il voit arriver les hommes du commissaire Jacques Fush (Claude Brasseur), membre de l'anti-gang. Furieux de se voir devancé, il fait appeler Police Secours par un de ses hommes. Dans le cafouillage qui s'ensuit, un des hommes de Fush est abattu par Sarlat...
Un grand classique des années 70-80 habité par deux personnalités marquantes. Un Claude Rich glaçant, frustré, manipulateur, «lâche, ambitieux et pourri» selon les propres termes de Marie (Marlène Jobert), face à un Claude Brasseur (couronné par les Césars), fonceur et désabusé, cachant sous une ironie ravageuse un tempérament dépressif larvé. L'histoire, assez banale dans son fondement - il est indispensable de retrouver Sarlat, le tueur, pour sauver la police aux yeux de l'opinion publique - est en fait pimentée de manière efficace par une peinture au vitriol de responsables politiques uniquement préoccupés de leur image et du prochain vote du budget, et de services de police sans cesse au bord de l'implosion. Certaines scènes ne manquent pas d'un cynisme assumé, à l'instar de celle où Colombani (François Périer) disserte sur la nécessité de redorer le blason des flics afin que la société ferme les yeux sur le fait qu'ils se défoulent sur les pédés, les Arabes ou les noirs.
L'autre réussite du film réside dans sa capacité à dépasser le simple polar primaire, d'une part en y injectant une ironie souvent payante et jouissive, et d'autre part en parvenant à insuffler dans cette confrontation d'égos machistes un art de l'ellipse qui la transfigure en une quasi tragédie romantique. À ce titre, le finale, mélancolique à souhait, prend la forme d'un duel suicidaire westernien. On pense évidemment à «Max et les ferrailleurs» sorti huit ans plus tôt, d'autant plus que les ressorts principaux des deux dramaturgies sont similaires. Mais l'oeuvre de Robin Davis, beaucoup plus riche qu'elle ne paraît au premier abord, n'a nul besoin de références pour s'installer au niveau des réussites mémorables de cette décennie.
Bernard Sellier




